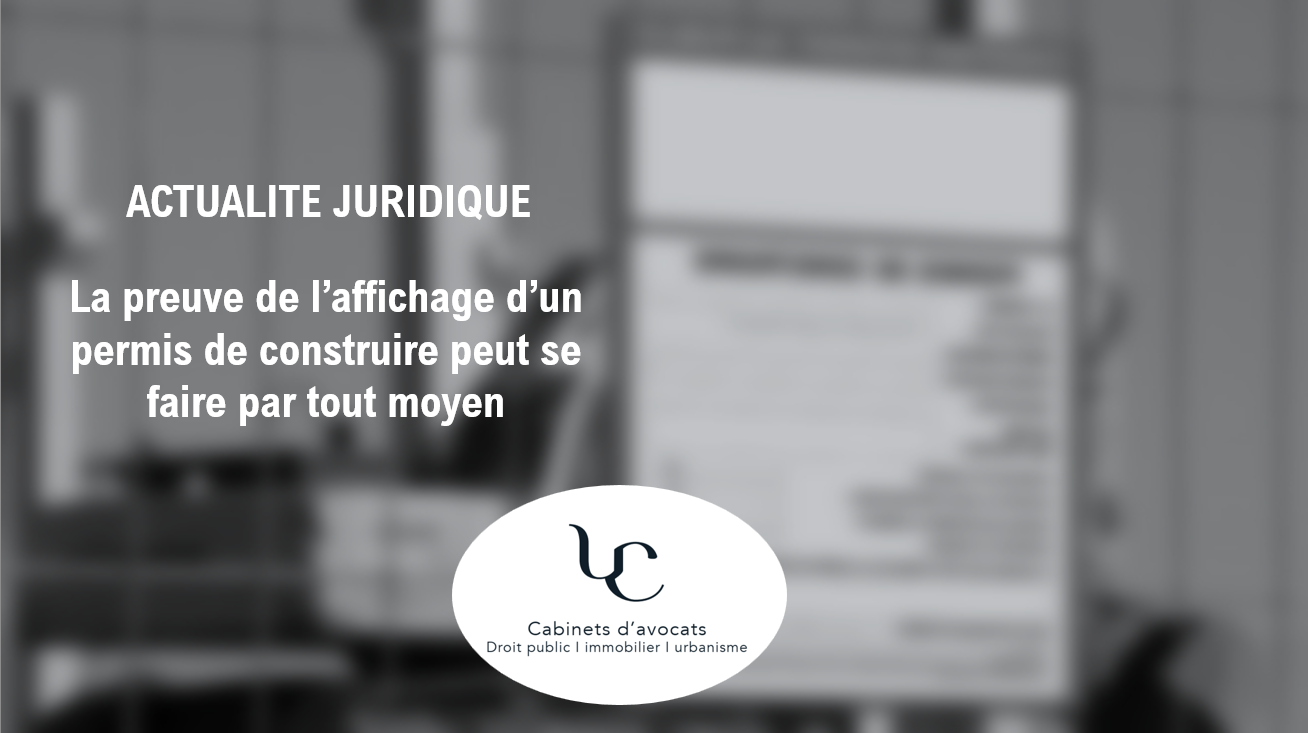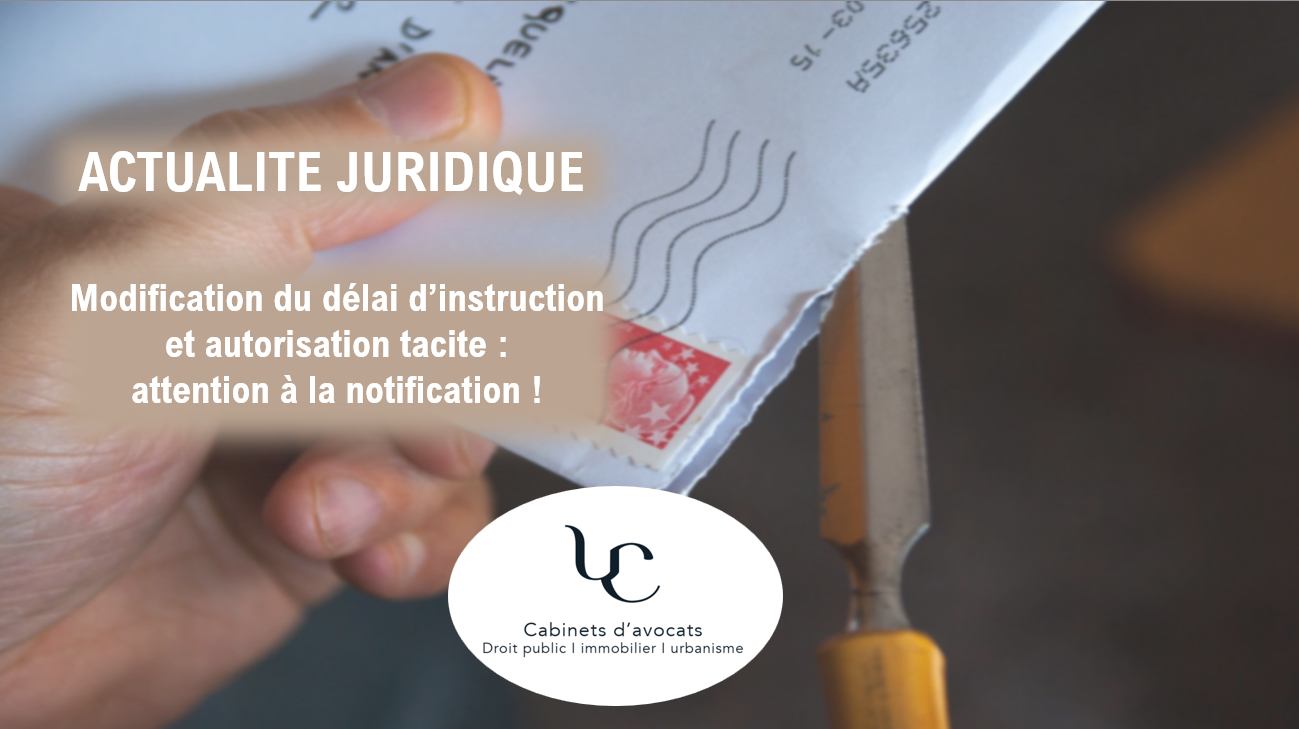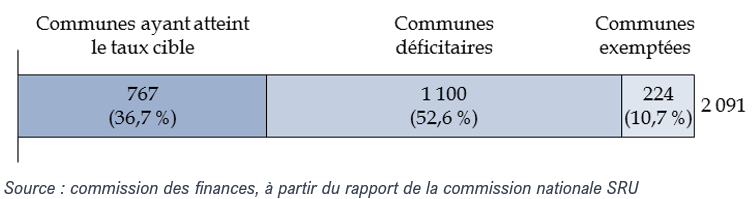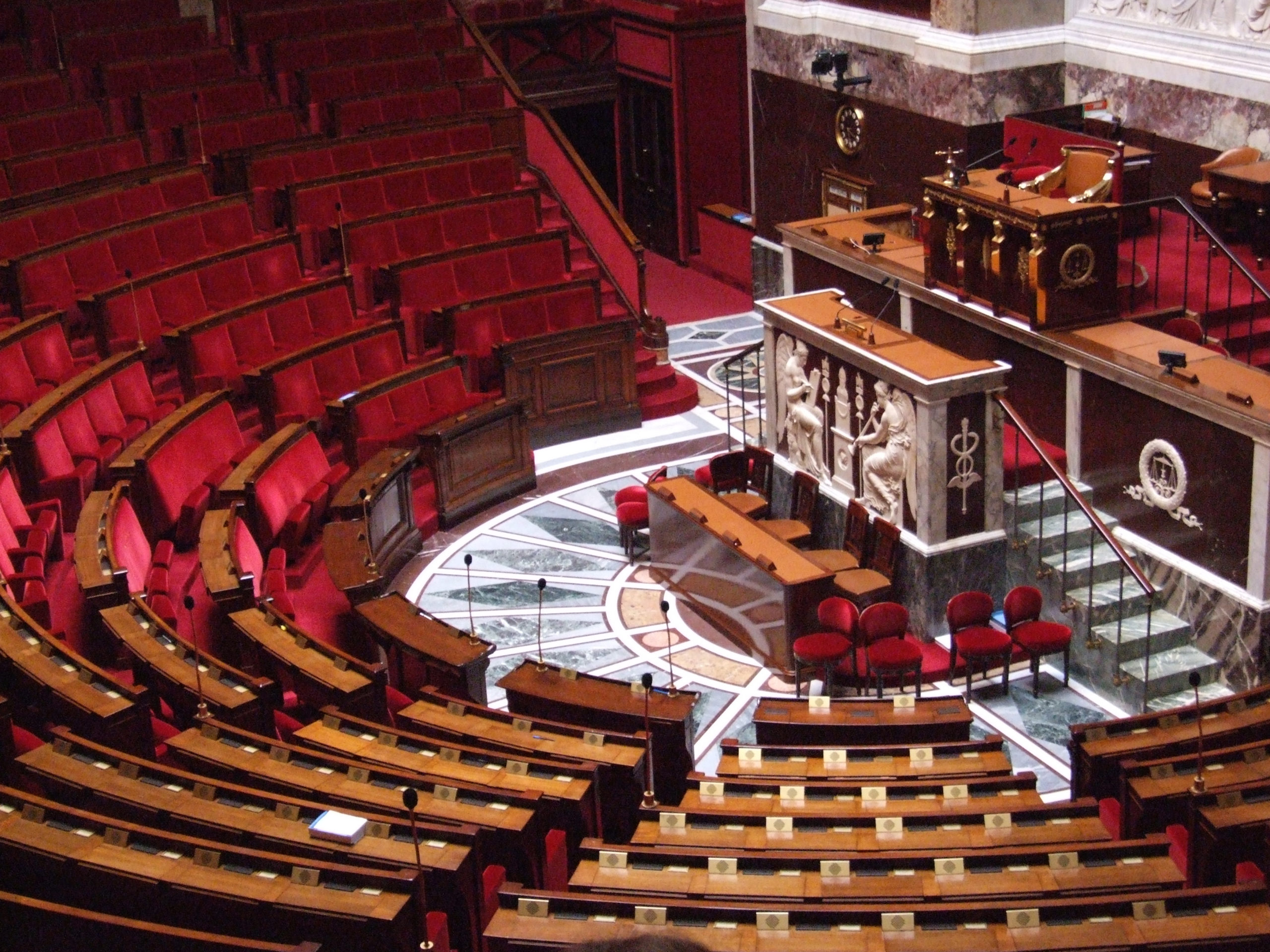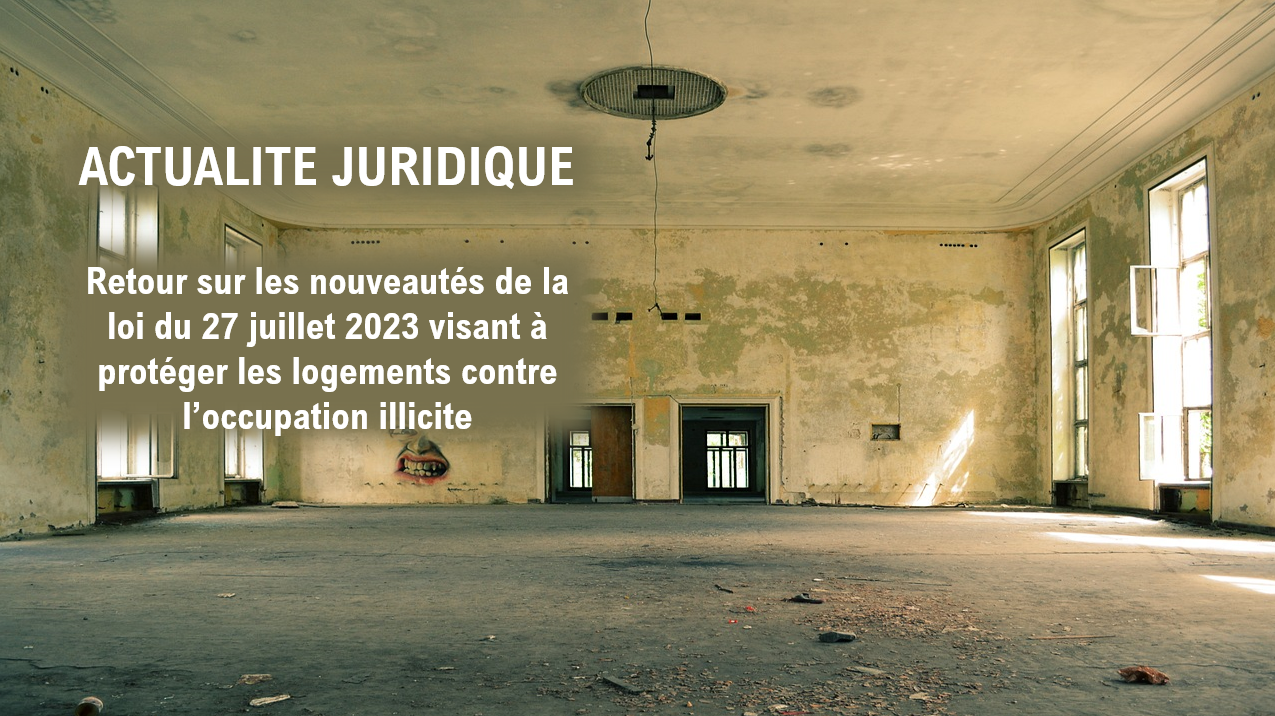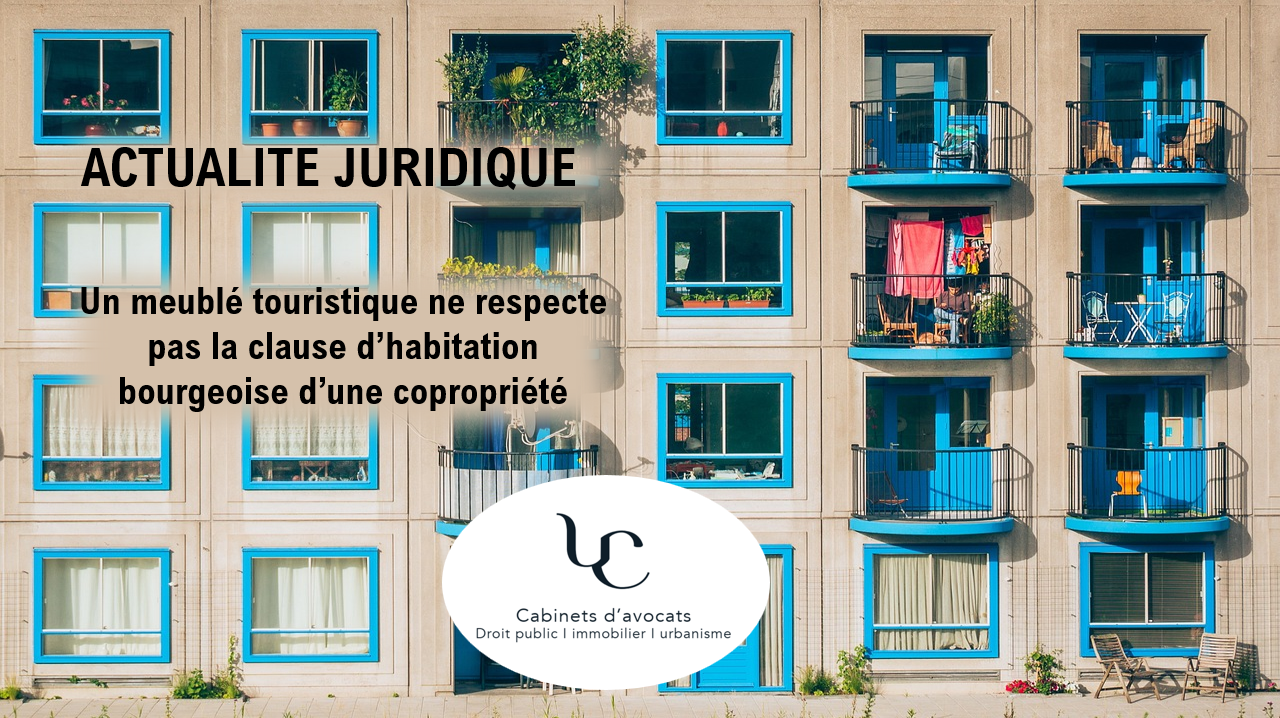Un règlement de la location touristique meublée ne peut pas soumettre obligatoirement toute autorisation à un accord préalable de la copropriété
Dans une décision du 31 janvier dernier, le Tribunal administratif de Nice a apporté une précision quant au rapport entre réglementation des locations meublées et copropriété.
En effet, le tribunal a eu à se prononcer sur la légalité d’une délibération du bureau métropolitain Nice Côte d’Azur du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er juillet 2021.
Saisi par une association de propriétaires, le Tribunal a estimé qu’aucune disposition n’était entachée d’illégalité à l’exception de l’article 2 qui prévoyait notamment que les propriétaires, au moment du dépôt de leur demande de changement d’usage, doivent prouver que celui-ci est autorisé dans leur copropriété en joignant à leur dossier : « une déclaration sur l’honneur, l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage, à défaut l’accord de la copropriété ».
En effet, le tribunal a jugé que cette disposition – qui soumet donc tout changement d’usage en vue de la location touristique meublée à la production de l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas expressément au changement d’usage, ou, à défaut, à la production de l’accord de la copropriété – conduit à soumettre discrétionnairement cette autorisation à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble et ce alors même que les statuts de la copropriété ne le prévoiraient pas, notamment dans le cas où le règlement serait muet quant à la question de la location touristique meublée ou en l’absence de règlement de copropriété :
« 22. D’autre part, ces dispositions, qui soumettent tout changement d’usage en vue de la location d’un local à usage d’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile à la production de l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas expressément au changement d’usage, ou, à défaut, à la production de l’accord de la copropriété, conduit à soumettre discrétionnairement cette autorisation à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble et ce alors même que les statuts de la copropriété ne le prévoiraient pas, notamment dans le cas où le règlement serait muet quant à la question de la location touristique meublée ou en l’absence de règlement de copropriété. Il permet ainsi à l’assemblée générale des copropriétaires de porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires. Par suite, l’association est fondée à soutenir que les dispositions du règlement qui prévoient, pour délivrer l’autorisation de changement d’usage, soit que le règlement de copropriété autorise expressément la location touristique meublée de courte durée, soit l’obtention d’une autorisation écrite de la copropriété à défaut de cette mention expresse dans le règlement, portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »
Le tribunal a en effet estimé que la disposition du délibération permet ainsi à l’assemblée générale des copropriétaires de porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Antoine de Griève
En savoir plus