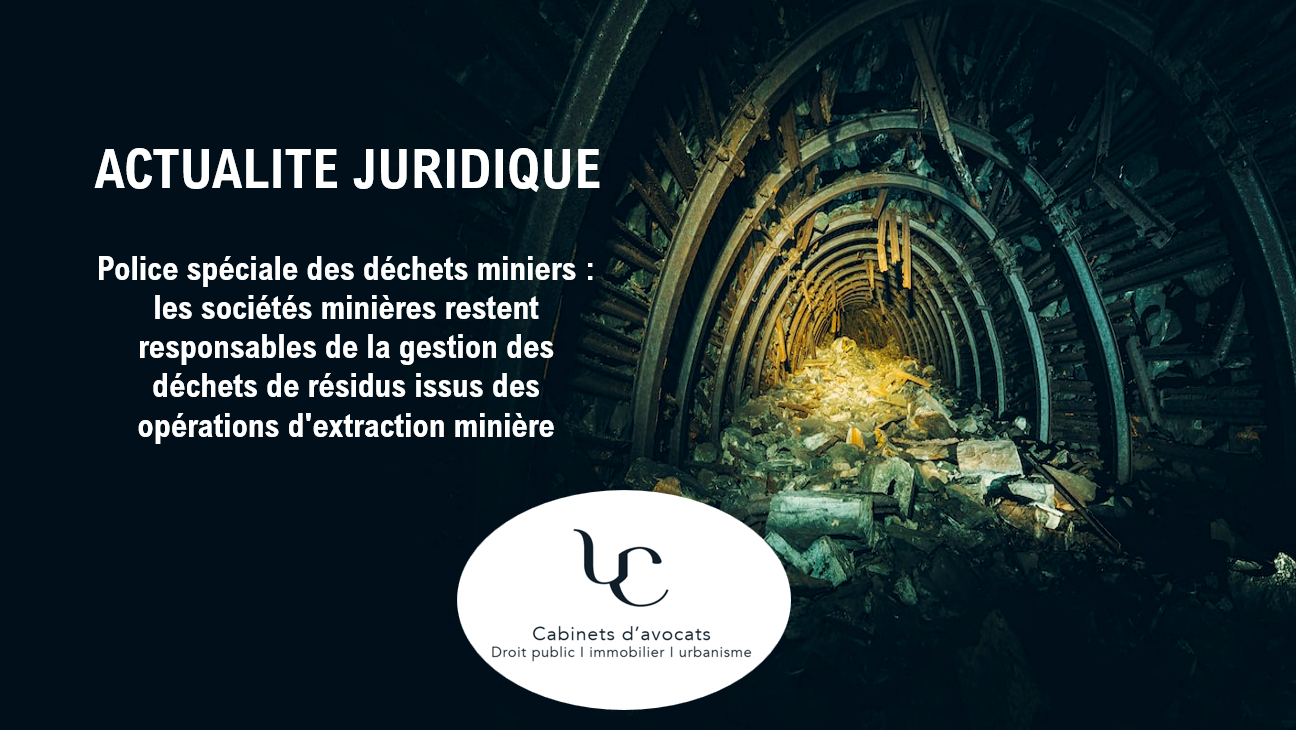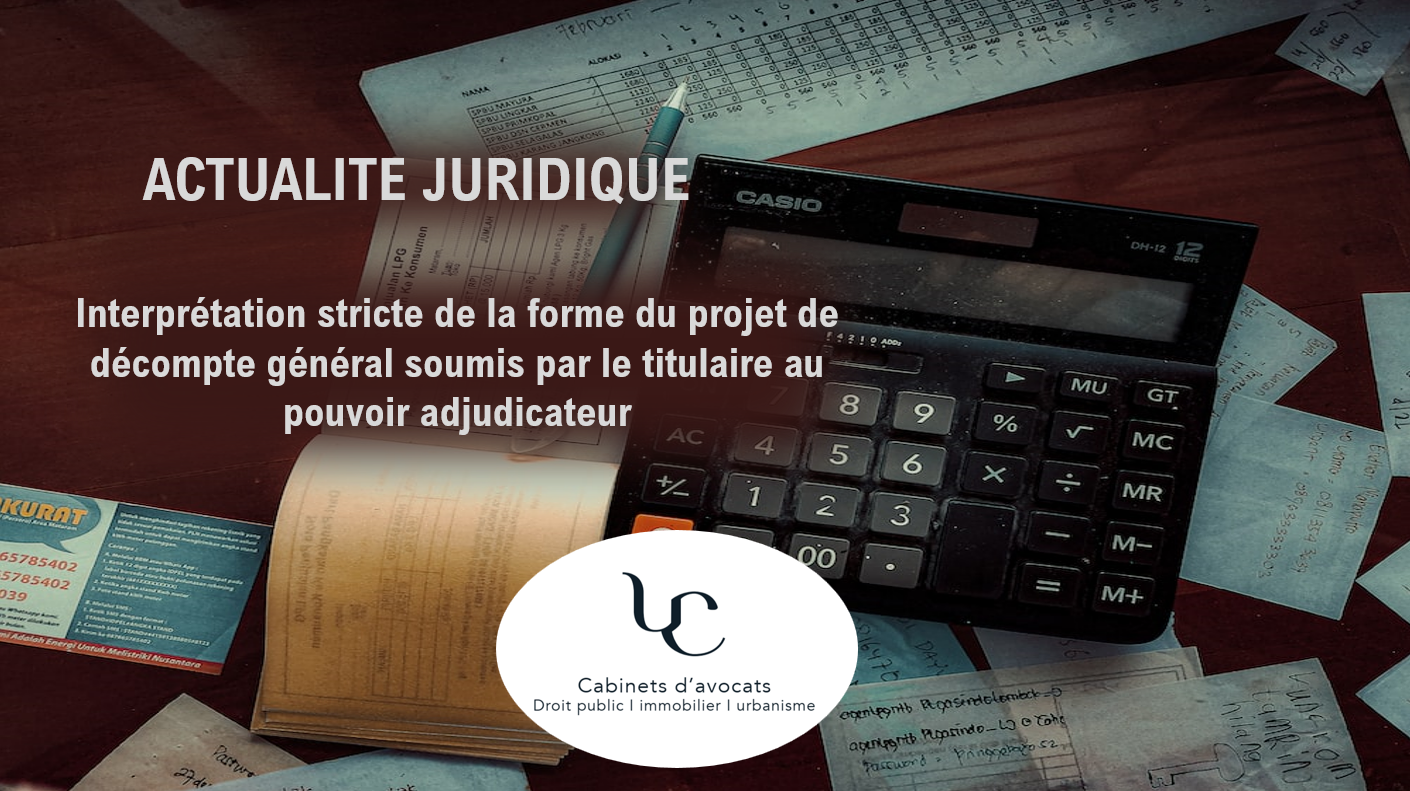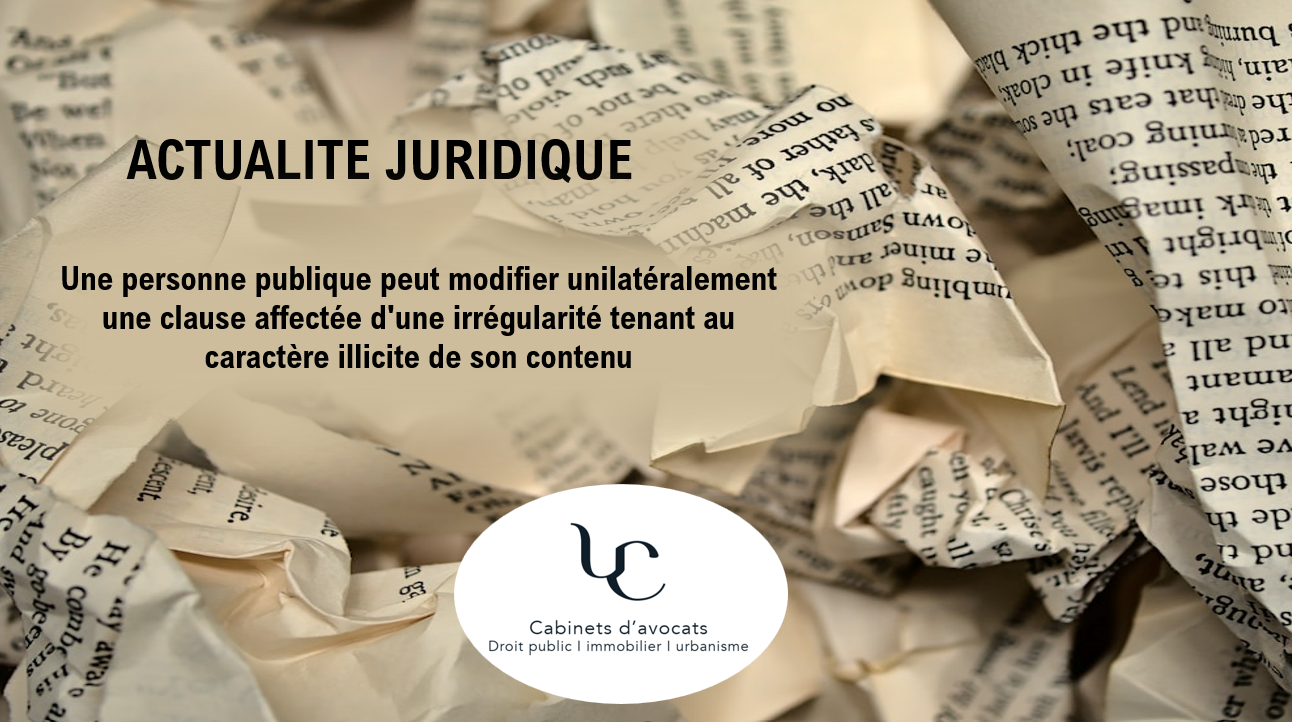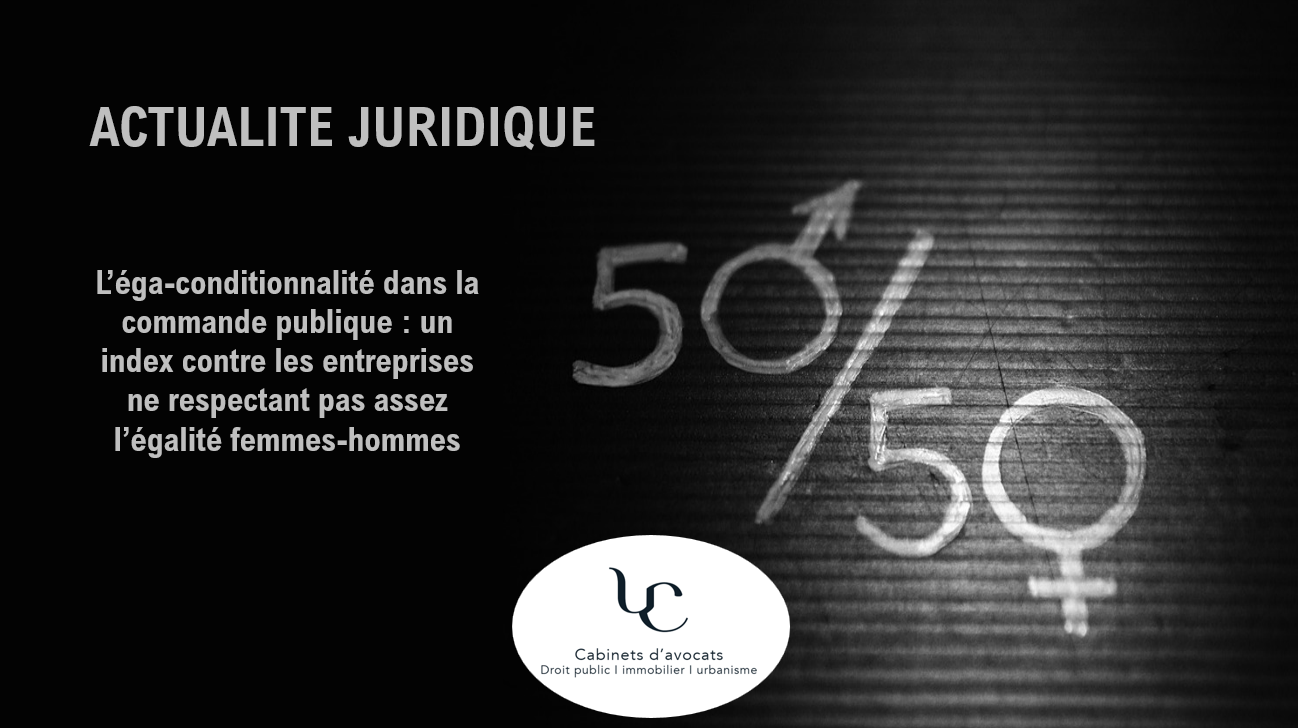Décret du 22 mars 2023 : Changement de destinations !
Dans un décret du 22 mars 2023, la Première Ministre et le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont apporté des modifications au Code de l’urbanisme en prenant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Ce décret, destiné avant tout aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux services déconcentrés de l’Etat, porte adaptation du contenu prévu dans le Code de l’urbanisme avec des dispositions devant entrer en vigueur au 1er juillet 2023 avec des dispositions transitoires pour les procédures en cours.
Il apporte des modifications importantes puisqu’il ajoute notamment la mention du secteur primaire dans la destination « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire ».
Il modifie également la liste des sous-destinations afin de créer une nouvelle sous-destination « lieux de culte » dans la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » ainsi qu’une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire ».
Ce changement vient répondre notamment aux nombreuses questions résultant du développement de la pratique des « dark stores » sur lesquels nous avons fait plusieurs articles !
Il corrige ensuite la nomenclature des servitudes d’utilité publique annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, une erreur de référence aux articles du même code concernant les servitudes de passage sur le littoral et l’intégration dans cette nomenclature d’une catégorie de servitude d’utilité publique prévue au code de l’environnement relative aux ouvrages et infrastructures nécessaires à la prévention des inondations.
Il ajoute enfin dans la liste des annexes au plan local d’urbanisme de quatre nouvelles annexes :
- la carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l’article L. 121-22-3 ;
- les périmètres où la pose de clôtures est soumise à déclaration préalable ;
- les périmètres où le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable ;
- les périmètres où le permis de démolir a été institué.